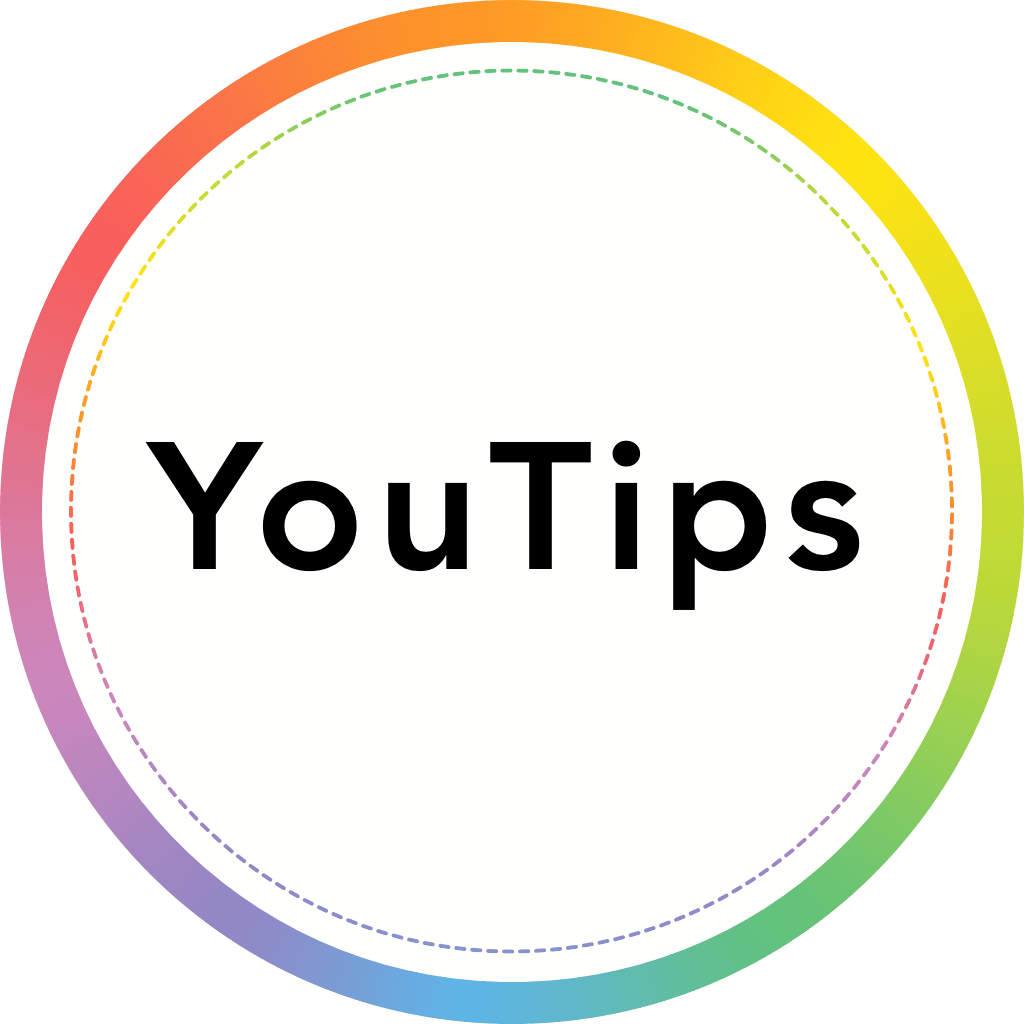Convention collective
Définition
Comprendre et appliquer la convention collective dans le spectacle
Définition de convention collective
Une convention collective est un accord écrit conclu entre organisations d’employeurs et syndicats de salariés. Elle complète le Code du travail par des règles adaptées à un secteur. Elle s’applique aux entreprises dont l’activité relève de son champ d’application. Dans le spectacle, plusieurs conventions coexistent selon la branche et la nature des productions.
Pour les intermittents du spectacle, la convention collective encadre notamment :
- les minima salariaux (cachets, heures, barèmes par fonctions) ;
- la durée et l’organisation du travail (répétitions, représentations, tournages, déplacements, travail de nuit) ;
- les indemnités, majorations, frais et primes (habillage, panier, transport, déplacements) ;
- la santé-prévoyance, la formation et la classification des emplois.
Elle s’impose aux CDD d’usage (CDDU), aux CDI et aux autres contrats, sous réserve des dispositions d’ordre public du Code du travail. Elle peut prévoir des dispositions plus favorables. Les références de la convention doivent figurer sur le bulletin de paie, avec l’IDCC (identifiant de la convention).
Historique de convention collective
Les conventions collectives se développent en France au XXᵉ siècle avec la montée de la négociation collective. Après 1945, leur extension par arrêté ministériel permet de les rendre obligatoires à l’ensemble d’un secteur. Les réformes de 2004, 2008 et 2017 réorganisent la hiérarchie des normes, renforcent le rôle de l’accord d’entreprise sur certains thèmes, et sécurisent l’articulation entre branche et entreprise. Dans le spectacle, des branches historiques se structurent autour du spectacle vivant, du cinéma, de l’audiovisuel et du disque. Des révisions périodiques ajustent les grilles de salaires, les classifications et les règles spécifiques aux tournées, captations, répétitions et régimes d’indemnisation.
Usage de convention collective
Identifier la bonne convention. Le critère principal est l’activité réelle de l’employeur. Le code NAF/APE oriente mais ne décide pas à lui seul. On vérifie le champ d’application de la convention, la présence d’un arrêté d’extension, puis on applique la convention la plus pertinente. Exemples fréquents dans le spectacle et l’audiovisuel :
- Spectacle vivant privé (théâtres, producteurs privés) ;
- Entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC) pour structures subventionnées ;
- Production audiovisuelle (fictions, documentaires, flux selon accords) ;
- Production cinématographique ;
- Édition phonographique ;
- Prestataires techniques pour le spectacle et l’événement ;
- Édition de musique et diffusion radiophonique ou télévisuelle selon les cas.
Champ d’application et extension. Une convention peut être étendue par le ministère du Travail. Une fois étendue, ses clauses obligatoires s’imposent aux entreprises du champ, même non adhérentes à une organisation patronale signataire. Certaines clauses ne sont pas étendues. Il faut lire l’arrêté pour connaître les exclusions.
Minima salariaux et classifications. Les grilles fixent des minima par métier, niveau, durée (heure, cachet, journée, semaine). Elles distinguent souvent répétitions, montage, balance, représentation, tournage, postproduction, studio, régie. Les cachets sont définis en valeur brute. Les conventions détaillent les majorations :
- travail de nuit, dimanche et jours fériés ;
- heures supplémentaires et dépassements ;
- astreintes et rappels ;
- indemnités de déplacement, hébergement et repas.
Temps de travail et repos. Le temps de travail se compte selon des règles propres à chaque branche. Les conventions définissent le repos quotidien et hebdomadaire, les coupures, les amplitudes maximales, la gestion des tournées et des séries de représentations, ainsi que les compensations en cas de dépassement ou de dérogation.
CDDU et mentions obligatoires. Dans le spectacle, le recours au CDDU est encadré par liste d’emplois et par usage constant. La convention précise les mentions du contrat, les délais de remise, la période d’essai éventuelle, les règles de report d’heures en cas de report de date, la gestion des annulations et le dédit. Les annexes prévoient des barèmes d’indemnités en cas de rupture anticipée ou d’annulation tardive selon le motif et le délai.
Frais professionnels et déplacements. Les conventions définissent le remboursement des dépenses engagées pour la mission. Elles précisent les niveaux d’indemnisation (forfaits paniers, per diem, billets, kilométrique), les conditions d’hébergement, les temps de trajet reconnus et les compensations lorsque le déplacement empiète sur le repos.
Prévention, santé et prévoyance. Beaucoup de conventions désignent des organismes de prévoyance et frais de santé pour les salariés, souvent paritaires. Dans le spectacle, le groupe Audiens est fréquentement mentionné. Les contributions conventionnelles peuvent financer la prévoyance, l’action sociale, la retraite complémentaire, et des fonds spécifiques pour la pénibilité et la prévention des risques.
Formation professionnelle. La branche désigne l’opérateur de compétences. Dans le secteur, Afdas est l’OPCO de référence. La convention peut prévoir des contributions spécifiques, des priorités de formation et des droits élargis pour les intermittents comme pour les permanents.
Articulation avec les accords d’entreprise. Depuis les réformes de 2017, la branche garde la primauté sur les thèmes « verrouillés » (minima hiérarchiques, classifications, égalité pro, mutualisation de la prévoyance, prévention des risques, etc.). Sur d’autres thèmes, un accord d’entreprise peut déroger, parfois dans un sens moins favorable. En l’absence d’accord d’entreprise, la convention de branche s’applique.
Procédure de négociation, révision et dénonciation. Les partenaires sociaux peuvent réviser une convention. Une dénonciation ouvre un délai de survie des clauses puis un régime transitoire. Les arrêtés d’extension et d’élargissement sont publiés au Journal officiel. Les mises à jour doivent être suivies, car les minima évoluent régulièrement.
Obligations de l’employeur. L’employeur doit :
- indiquer la convention collective sur le bulletin de paie et tenir un exemplaire à disposition des salariés ;
- appliquer les minima et règles d’organisation du travail ;
- affilier aux organismes désignés si la convention l’impose ;
- réaliser les affichages et informations obligatoires ;
- respecter les procédures de représentation du personnel et de négociation lorsqu’elles s’appliquent.
Droits et réflexes du salarié intermittent. Le salarié peut demander l’accès au texte applicable, vérifier la conformité de sa rémunération au minima, contester une classification erronée, et solliciter les indemnités prévues. Il peut consulter les dernières versions sur les bases officielles et alerter en cas de non-application.
À savoir / Comparaisons utiles
Convention collective vs accord de branche. Dans le langage courant, on confond les deux. Techniquement, l’accord de branche est l’ensemble des textes négociés au niveau de la branche, dont la convention est le texte central. On parle souvent indifféremment de « convention de branche ».
Convention collective vs accord d’entreprise. L’accord d’entreprise peut primer sur de nombreux sujets si la loi le permet. Il ne peut pas descendre sous les minima hiérarchiques étendus de la branche ni contredire les thèmes verrouillés. Toujours vérifier l’articulation prévue par la loi et par la convention.
Convention collective vs usage d’entreprise. Un usage est une pratique constante, fixe et générale. Il ne remplace pas une clause conventionnelle. Il peut être dénoncé selon une procédure spécifique et ne peut contredire un texte étendu.
IDCC, APE et preuve d’application. L’IDCC identifie la convention. Le code APE/NAF éclaire l’activité mais ne suffit pas. En cas de doute, on confronte l’objet social, l’activité réelle et le champ d’application du texte. La mention d’une convention erronée sur la fiche de paie peut être rectifiée si l’activité relève d’une autre convention plus pertinente.
Intermittence et assurance chômage. La convention collective règle le contrat de travail et la relation salariale. L’indemnisation chômage des intermittents relève d’accords d’assurance chômage et de règles distinctes. Ne pas confondre minima conventionnels et montants d’allocations.
Calcul des cachets et heures. Certaines conventions précisent la conversion des cachets en heures pour le calcul des heures supplémentaires, des majorations et des repos compensateurs. Les définitions varient selon les branches. Toujours utiliser la grille et les notes de calcul du texte applicable.
Mise à jour des minima. Les barèmes évoluent. Utiliser les versions consolidées et vérifier les avenants récents, surtout avant une embauche, une tournée ou un tournage. Une version périmée expose à des rappels de salaires et à des pénalités.
Clauses sensibles. Les clauses de cession de droits, d’exclusivité, de mobilité et de confidentialité doivent être compatibles avec la convention, proportionnées au poste, et, le cas échéant, compensées. Les conventions du cinéma et de l’audiovisuel contiennent souvent des annexes spécifiques à ces sujets.
Entreprises multi-activités. Une même structure peut relever de plusieurs conventions si des activités distinctes coexistent avec des équipes séparées. Cela requiert une analyse fine et une organisation interne claire.
Réseaux et tournées. Les conventions du spectacle vivant détaillent les durées maximales de trajet, les temps de montage et démontage, les repos, les hébergements et les per diem. Les productions audiovisuelles et cinéma encadrent les amplitudes de tournage, la sécurité des transports et le repos journalier.
En bref
La convention collective est le mode d’emploi concret du travail dans la branche. Elle fixe minima, classifications, temps de travail, majorations et protections sociales. Elle s’applique selon l’activité réelle et, si elle est étendue, à toutes les entreprises du champ. Les intermittents y trouvent les barèmes de cachets, les règles de répétitions et de tournage, et les indemnités usuelles. Les employeurs y trouvent un cadre sécurisé pour recruter en CDDU ou CDI, organiser les équipes et négocier en entreprise. Vérifier l’IDCC, suivre les avenants, conserver la preuve de l’application et mettre à jour les contrats.
Liens utiles
Pour aller plus loin, vérifier à chaque embauche : l’IDCC mentionné sur la fiche de paie, l’arrêté d’extension le plus récent, la grille des minima en vigueur, les avenants applicables à la fonction et au mode de production. Associer les obligations conventionnelles aux plans de formation Afdas, à la prévoyance Audiens et aux règles d’hygiène et sécurité, notamment en déplacements et tournages. Ajuster les contrats CDDU et les feuilles de service en conséquence.
Aller plus loin
Astuces et aide :
Si vous rencontrez des difficultés sur le site ou si vous souhaitez nous poser une question, nous vous invitons à consulter notre rubrique « Assistance » :
- Notre rubrique “Assistance”
- Besoin d’aide sur Logic Pro ?
- Découvrez nos astuces MAO sur Logic Pro en Home Studio
Nos glossaires :
- Glossaire Apple
- Glossaire des Artistes
- Glossaire de la Formation Professionnelle
- Glossaire du Home Studio
- Glossaire de l’Intelligence Artificielle (IA)
- Glossaire des Microphones
- Glossaire de la Musique
- Glossaire de la Photographie et de la Vidéo
- Glossaire du Web
Nos cours en ligne :
- Les cours gratuits
- Tous les cours en ligne
- Les cours “Univers Apple”
- Les cours “Musique, MAO, Piano”
- Les cours “Communication digitale”